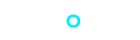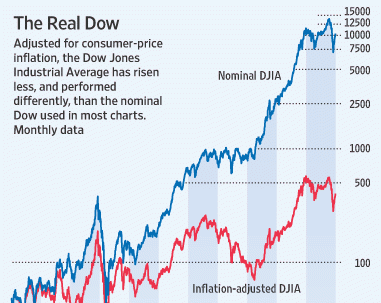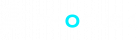Le sommet de l’OTAN s’est terminé sans trop d’accrocs ce mercredi 25 juin 2025. La déclaration finale réaffirme l’attachement des 32 États membres à l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord et engage ces derniers à atteindre 5% de leur PIB alloué à la défense d’ici à 2035.
Dans un contexte de bouleversement de l’échiquier mondial, cette rencontre visait à raffermir les positions et à montrer que les occidentaux étaient prêts à sortir les crocs face à la menace russe, explicitement mentionnée dans la déclaration finale.
Un effort considérable s’annonce donc. En effet, 5% du PIB qui part dans la défense, comme l’exigent les États-Unis, c’est énorme. Analysons donc cela pour mieux comprendre ce que la France doit accomplir pour atteindre cet objectif et les conséquences pour la défense européenne.
Comment se composent ces 5% du PIB alloués à la défense ?
Nous pouvons diviser ce pourcentage en 2 parties : 3.5% sera consacré aux dépenses militaires stricto sensu, comme les chars, les missiles air-sol, les avions de chasse, etc. Le 1.5% restant partira dans tout ce qui garantit la résilience et la défense, comme la cybersécurité, les infrastructures critiques, la logistique, la capacité industrielle… Cette dernière part n’est pas à prendre à la légère du tout, et constitue même la colonne vertébrale de l’architecture défensive d’un pays. À titre d’exemple, des cyberattaques massives ont précédé l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, perturbant les systèmes de communication.
Le terme « infrastructure critique » est volontairement vague pour donner une assez grande marge de manœuvre aux États dans leur financement. Ce qu’il faut comprendre derrière cela, c’est que les pays membres doivent se rendre antifragiles, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir des infrastructures suffisamment solides pour assurer une résilience et une protection des citoyens en cas de crise. Cela implique donc d’assurer un bon fonctionnement du secteur industriel et cyber certes, mais aussi des réseaux routiers, des hôpitaux et des réseaux électriques.
Les sources d’approvisionnement en énergie sont aussi cruciales pour garantir sa souveraineté, en démontre le coup sévère qu’a pris l’Allemagne lors de l’invasion de l’Ukraine du fait de sa dépendance au gaz russe. Ainsi, est-il nécessaire de coupler le politique au militaire.
Quel effort doit fournir la France ?
La France alloue déjà 2% de son PIB au renforcement de sa capacité militaire, comme le voulait la déclaration de l’OTAN de 2022. Cette part, alliée à une autonomie stratégique en termes d’équipement (on parle alors de BITD, ou Base Industriel et Technologique de Défense), fait qu’elle dispose d’une armée que l’on dit en « Bonzaï » : elle a tout, mais en petite quantité. Cela implique qu’elle ne peut durer que 3 à 4 semaines dans un conflit de haute intensité similaire à la guerre en Ukraine. S’engager à passer de 2% à 5% devrait donc permettre d’initier un changement global dans l’écosystème militaire français.
En effet, à 5%, la France commencerait à avoir véritablement les moyens de ses ambitions. Elle peut axer ce budget dans la recherche en quantique, en IA, en new space (armes spatiales et satellites), en cybersécurité et en drones, afin de rattraper son retard dans la tech. Elle pourrait de plus retrouver une grande capacité de production de transports lourds et moderniser l’équipement des fantassins.
Mais cette énumération ressemble à une liste au Père Noël. Elle ne prend pas en compte le besoin d’une vision stratégique chez les dirigeants français. Il ne faut pas qu’ils se laissent éparpiller par tous les gadgets que l’industrie militaire peut proposer. En fait, Le dilemme est là : faut-il conserver une industrie de très haute technologie militaire au détriment de la capacité à endurer un conflit de haute intensité sur le long terme, ou bien accepter de diversifier son secteur de production pour produire des équipements moins chers et en grande quantité ? Tout dépend du degré d’influence du complexe militaro-industriel français sur ses dirigeants politiques, et il est très élevé. Quelles peuvent être alors les solutions ? Eh bien, nous en voyons 2 : la mise en commun et la planification.
La mutualisation des budgets de la défense à l’échelle européenne
Cela serait comme une sorte d’apogée de l’intégration des pays d’Europe, sur laquelle peut se construire un narratif pour les générations futures, celui de la glorieuse et vertueuse Europe qui se soude pour faire courageusement face à l’ogre russe (que de cynisme). Outre cet aspect idéologique, l’Europe représente la 2ᵉ dépense dans la défense au monde, devant la Chine, soit quelque 450 milliards d’euros (en ajoutant le Royaume-Uni). En se coordonnant dans tous les secteurs mentionnés plus haut, le continent serait capable de largement concurrencer la Chine, voire les USA dans certains secteurs, et d’enfin devenir plus qu’un simple marché aux yeux du monde.
Bien évidemment, cette solution est plus idéaliste qu’autre chose. Elle supposerait que les pays de l’Union abandonnent leur souveraineté nationale, chose qui a été pensée en 1953, mais rapidement abandonnée. Pour rester dans l’esprit de ce qu’a fait l’UE depuis sa création, c’est-à-dire chercher l’équilibre entre concurrence de marché et mutualisation, les instances dirigeantes planchent plutôt sur un vaste et ambitieux programme à 800 milliards d’euros, le plan ReArm Europe.
ReArm Europe : une étape de plus dans la défense européenne ?
Ce plan vise à donner une véritable impulsion à l’Europe de la défense. La mise en commun des achats d’équipement, ainsi que des investissements massifs dans le secteur de l’industrie militaire et dans l’innovation technologique est prévue. Pour donner corps à cette initiative, l’UE compte utiliser l’incitation financière comme principal levier, à travers l’instrument SAFE (Agir pour la sécurité en Europe) qui vise à combler les trous dans l’écosystème militaro-industriel européen et à inciter à des acquisitions conjointes.
Pour soutenir cette industrie de la défense, les commissions de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ont proposé la création de l’EDIP (Programme pour l’industrie européenne pour la défense) qui vise à ce que les pays membres se fournissent au moins à 70% en produits européens, tout en garantissant un approvisionnement continu des équipements essentiels.
Tout cela promet donc un avenir radieux pour les industriels européens de la défense, qui verront le cours de leurs actions grimper en flèche.
Comment l’UE va-t-elle financer ce plan ?
La Commission va exceptionnellement autoriser les États membres à activer la clause dérogatoire du Pacte de stabilité et de croissance. Cela leur permettra d’accroître leur déficit pour s’équiper et se renforcer militairement. Ainsi, si tous les pays augmentent leurs dépenses de 1.5% du PIB, 650 milliards seront mobilisables au bout de 4 ans. Point noir, cette dette créée n’est pas une forcément un problème si elle est mutualisée au sein de l’UE, or elle ne le sera qu’en partie.
Autre moyen pour alimenter la défense européenne, emprunter 150 milliards d’euros sur les marchés internationaux pour compléter le financement du plan. Elle n’exclut pas aussi la possibilité de mobiliser les 340 milliards d’euros du fonds de cohésion.
Dans cette optique, la hausse du budget de la défense exigée par la déclaration de l’OTAN peut servir au financement de ReArm Europe. On changerait alors d’échelle, ce qui questionnerait la part du PIB national alloué à la défense comme mesure pertinente pour déterminer si l’objectif est atteint ou pas. Aussi, cette impulsion européenne doit-elle faire prendre conscience au continent de son rapport à l’OTAN.
L’Europe de la défense comme palliatif à l’OTAN ?
Cette mutualisation européenne, bien que limitée dans le temps pour le moment, permettrait à terme de disposer de très solides moyens défensifs et d’une indépendance industrielle vis-à-vis des USA. On l’a bien vu, ce pays n’est plus fiable, le gouvernement de Trump se caractérise par une imprévisibilité et une relative animosité à l’encontre des Européens, ce qui n’en fait plus un allié stable, mais un concurrent. Mais encore faut-il se détacher totalement de ce géant ivre. En effet, plusieurs chaînes lient encore le destin de la défense européenne à celui des États-Unis :
- La capacité de dissuasion nucléaire européenne n’est pas au point : diffuser l’arme nucléaire à l’ensemble des pays de l’UE ne fait, pour le moins, pas consensus du tout. Il y a donc encore besoin de l’arsenal américain pour rassurer tout le monde.
- L’UE est une technocratie néolibérale : son système repose sur des incitations et le maintien d’une concurrence de marché qui grève des secteurs stratégiques, comme l’électricité et la santé, faisant que les instances dirigeantes peinent à se doter d’une vision d’ensemble dans le temps long. De plus, renforcer le pouvoir d’influence du complexe militaro-industriel se fait au prix d’un déséquilibre de l’économie, avec des secteurs sous-financés par rapport à d’autres.
- Ces dispositifs d’achat en commun prévus remettent question la souveraineté des États membres et oublie de prendre en considération les guerres d’égo entre constructeurs. La France veut par exemple que son industrie militaire possède plus de parts de marchés que celle allemande, limitant alors la coordination entre pays.
On retient alors que le manque de planification peut sérieusement handicaper l’UE dans sa quête d’autonomie défensive.
Conclusion
La hausse du budget alloué à la défense marque la volonté d’enterrer une bonne fois pour toutes la période de la mondialisation heureuse des années 1990-2000, au profit de la défense européenne. Les ennemis potentiels ne sont plus des terroristes armés d’AK-47, mais bien des soldats équipés et formés, disposant d’un arsenal terrestre, maritime et aérien étendu. L’UE, dans sa forme actuelle, rend difficile l’établissement d’une vision véritablement stratégique, ce qui fait qu’elle dépend encore de l’OTAN. Si elle n’entame pas un changement profond dans son fonctionnement, elle n’arrivera pas à s’imposer comme un acteur géopolitique crédible et restera ce gigantesque marché cramponé à l’idée de rationalité dans un monde qui ne l’est plus.
Investir dans les devises au sein d’un monde qui se fragmente : la solution Phocus1
Le marché des devises est très sensible aux changements géopolitiques et macro-économiques, ce qui est intéressant pour investir.
Phocus1 est un fonds luxembourgeois innovant, spécialisé dans les marchés de devises. Il permet à ses investisseurs d’accéder à une stratégie diversifiée, gérée par des experts du marché des devises et centrée sur des devises fortes.
- Ticket d’entrée : 125 000 €
- Objectif de rendement net annuel : +10 %
- Régulation : Cadre luxembourgeois, reconnu pour sa stabilité et sa sécurité juridique.
- Liquidité : mensuelle à horizon de placement 12 mois.
Avantages de la solution Phocus1
- Protection contre l’inflation et la volatilité
- Exposition à plusieurs devises majeures (USD, EUR, CHF, AUD, etc.)
- Gestion active avec arbitrages en temps réel
- Pas d’exposition directe aux actions ou aux marchés émergents
- Compatible avec des objectifs de diversification patrimoniale
- Pour les investisseurs avertis, minimum d’investissement 125K.
📧 Envie d'en savoir plus sur notre solution d'investissement, contactez-nous
Sources :
OTAN. (2025, 25 juin). Déclaration du Sommet de La Haye publiée par les chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’Alliance atlantique. https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_236705.htm
Conseil de l’Union européenne. (2025, 27 mai). Instrument SAFE : le Conseil adopte un montant de 150 milliards d’euros pour stimuler les acquisitions conjointes dans le domaine de la sécurité et de la défense européennes. https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2025/05/27/safe-council-adopts-150-billion-boost-for-joint-procurement-on-european-security-and-defence/
Commission européenne. (2025, 12 février). Plan ReArm Europe : la Commission propose des mesures pour renforcer la capacité industrielle de défense de l’UE et la sécurité commune. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_25_793
Institut Avant-Garde. (2025, 4 juin). ReArm Europe : quels financements pour la défense européenne ? https://www.institutavantgarde.fr/rearm-europe-quels-financements-pour-la-defense-europeenne/
Conseil de l’Union européenne. (2025, 26 juin). Conclusions du Conseil européen sur la défense et la sécurité européennes. https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2025/06/26/european-council-conclusions-on-european-defence-and-security/